Version française / Actualités
- Recherche - CLM,
Kαθαρσεις και ὑστερα. Bien réglées, mal lunées - Journée d'étude sur les menstruations dans l'Antiquité grecque
Publié le 30 avril 2025
–
Mis à jour le 12 juin 2025
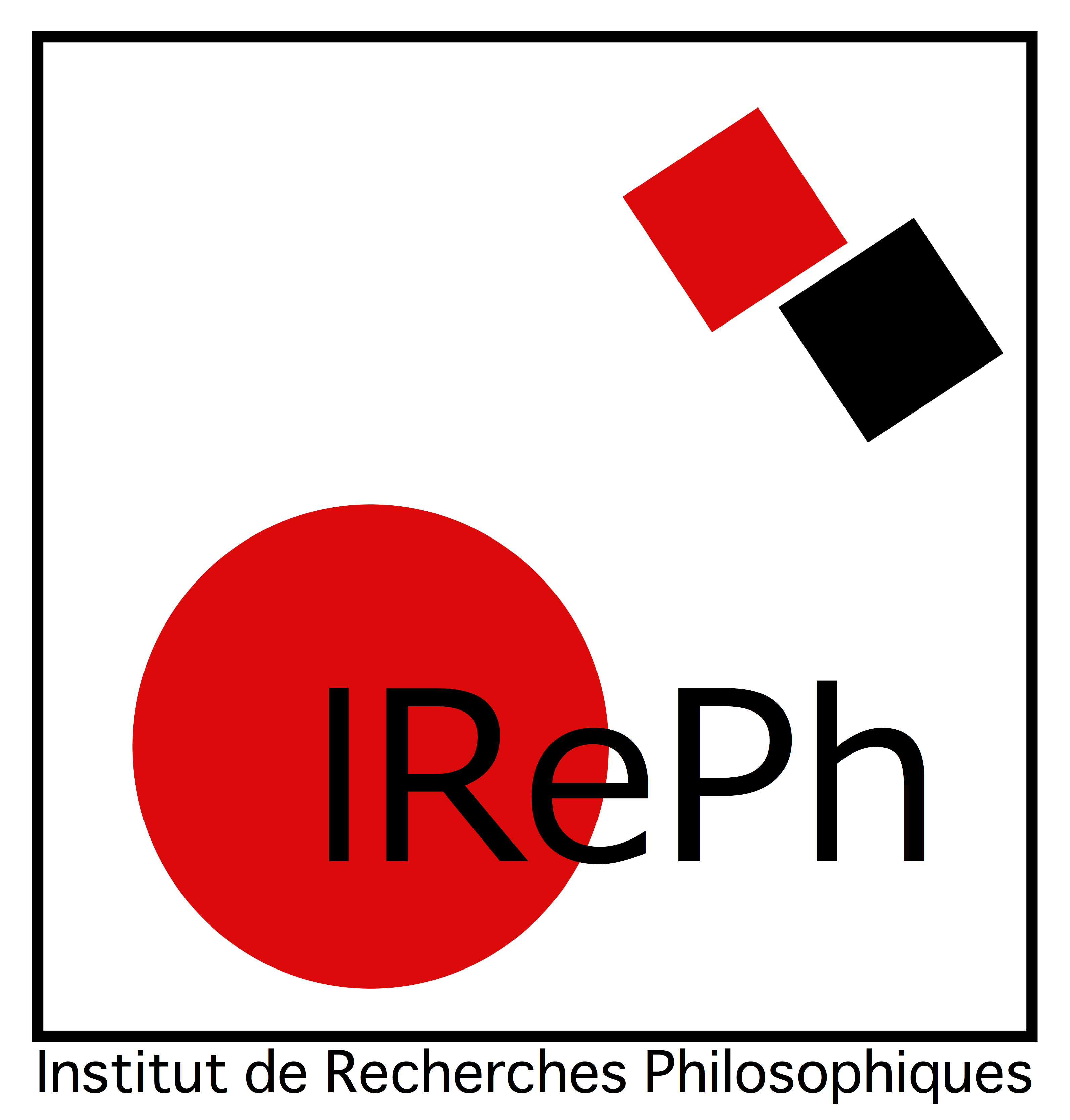
Avec la participation de Sophia CONNELL, Marie de GANDT, Clotilde HEINRICH, Marion POLLAERT
Date(s)
le 22 mai 2025
9h - 17h30
Lieu(x)
Bâtiment Max Weber (W)
Salle de séminaire 2
Kαθάρσεις καὶ ὑστέρα ; bien réglées, mal lunées
Les menstruations dans l’Antiquité grecque
Le fonctionnement du corps de la femme, et plus spécifiquement celui de son appareil génital, font l’objet de nombreux commentaires dans les corpus grecs anciens. Les médecins, au premier chef, s’intéressent à l’influence de l’utérus et des règles non seulement sur la santé physique des femmes, mais parfois également sur leurs états psychiques. Au-delà du corpus hippocratique, on trouve chez les philosophes des analyses approfondies de l’appareil reproductif féminin, qui sont entremêlées de considérations irréductibles aux questions médicales. Dans le Timée, Platon écrit que l’existence de la femme procède d’une déchéance de l’être humain mâle à l’issue d’une existence lâche et injuste. De là proviennent les organes génitaux, les désirs érotiques, et l’apparition d’un utérus que les pages 91b-d décrivent comme un animal brutal, tyrannique, dangereux pour la femme. Aristote, dans ses traités zoologiques, appuie le rapport hiérarchique d’après lequel il distingue les deux sexes sur une analyse de leurs organes génitaux : la différence entre le mâle et la femelle est aussi distinction entre le pur et le moins pur, ainsi que le chaud et le froid, le fort et le faible, et ce concomitamment à la distinction entre l’acte et la puissance. En outre, si les règles sont pour les femelles de toutes les espèces sexuées nécessaires à l’équilibre d’un organisme vivant, Aristote n’associe pas seulement leur déséquilibre à l’irruption de maladies, mais également à l’apparition de comportements déréglés. Ainsi les discours anciens sur les règles et l’utérus des femmes semblent-ils révéler l'ambiguïté d’une fonction naturelle investie de questionnements moraux. L’appareil reproducteur féminin perpétue un ordre harmonieux, et pourtant il révèle un certain nombre de préoccupations inquiètes. En témoigne une anecdote rapportée à propos d’Hypatie d’Alexandrie, qui aurait brandi un tissu imbibé de son sang menstruel pour repousser un prétendant importun : « Voilà ce que tu aimes, dit-elle, ce n'est pas beau ».
Kαθάρσεις καὶ ὑστέρα ; bien réglées, mal lunées
Menstruation in Ancient Greece
The functioning of a woman's body, and more specifically that of her reproductive system, is the subject of much commentary in the ancient Greek corpus. Physicians, in particular, were interested in the influence of the uterus and menstruation not only on women's physical health, but sometimes also on their mental state. In addition to the Hippocratic corpus, philosophers also produced in-depth analyses of the female reproductive system, interspersed with considerations that were irreducible to medical questions. In the Timaeus, Plato writes that the existence of women stems from the degeneration of the male human being at the end of a cowardly and unjust existence. This is the origin of the genitals, erotic desires and the appearance of a uterus that pages 91b-d describe as a brutal, tyrannical animal that is dangerous for women. In his zoological treatises, Aristotle bases the hierarchical relationship according to which he distinguishes the two sexes on an analysis of their genitalia: the difference between male and female is also a distinction between the pure and the less pure, as well as between hot and cold, the strong and the weak, and this is concomitant with the distinction between act and potency. Moreover, while for females of all sexed species, menstruation is considered necessary for the equilibrium of a living organism, Aristotle associates its imbalance not only with the outbreak of disease, but also with the appearance of disordered behaviour. The ancient discourses on menstruation and the female uterus thus seem to reveal the ambiguity of a natural function invested with moral questioning. The female reproductive system perpetuates a harmonious order, yet it reveals a number of anxious concerns. This is borne out by an anecdote about Hypatia of Alexandria, who brandished a cloth soaked in her menstrual blood to repel an unwelcome suitor: ‘That's what you like, ’ she said, ‘it's not beautiful’.
Programme
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Introduction de la journée
9h45 : Sophia CONNELL (Birkbeck, University of London) - Do women count? Female bodies and the cycles of life in ancient Greek philosophy and science
10h45-11h : Pause café
11h : Clotilde HEINRICH (ENS - Université de Franche Comté) - Parthenoi, règles et entrée dans la sexualité
12h-14h : Pause déjeuner
14h : Julie MESTERY (Université Paris Nanterre) - Efféminé et travesti : performer le corps féminin dans les Thesmophories
15h-15h15 : Pause café
15h15 : Marion POLLAERT (Centre Jean Pépin) - Οὐδὲν καλόν entre cynisme et platonisme : Hypatie et la monstration des menstrues
16h15-16h30 : Pause café
16h30 : Marie de GANDT (Université Bordeaux Montaigne) - Le pur et l'impur: rouvrir la misogynie antique.
17h30 : Conclusion de la journée
9h30 : Introduction de la journée
9h45 : Sophia CONNELL (Birkbeck, University of London) - Do women count? Female bodies and the cycles of life in ancient Greek philosophy and science
10h45-11h : Pause café
11h : Clotilde HEINRICH (ENS - Université de Franche Comté) - Parthenoi, règles et entrée dans la sexualité
12h-14h : Pause déjeuner
14h : Julie MESTERY (Université Paris Nanterre) - Efféminé et travesti : performer le corps féminin dans les Thesmophories
15h-15h15 : Pause café
15h15 : Marion POLLAERT (Centre Jean Pépin) - Οὐδὲν καλόν entre cynisme et platonisme : Hypatie et la monstration des menstrues
16h15-16h30 : Pause café
16h30 : Marie de GANDT (Université Bordeaux Montaigne) - Le pur et l'impur: rouvrir la misogynie antique.
17h30 : Conclusion de la journée
Mis à jour le 12 juin 2025







